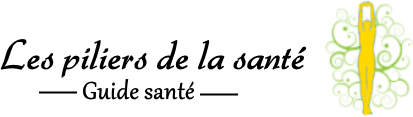La méditation ou le pouvoir de l’esprit

Introduction
« A quoi doit-on penser quand on médite ? ». Cette question, incontournable dès que l’on aborde la méditation, reflète la déroute des néophytes face à l’apparente complexité de cette discipline. Et pour cause : si la méditation est l’art du silence intérieur, il y a (ironiquement) bien trop de mots pour la décrire. C’est pourquoi je vous propose un tour d’horizon clair et concis de cette discipline, dont on parle tant et que l’on connaît pourtant si peu.
Pourquoi choisir la méditation pour entretenir ou améliorer sa santé psychique ? En quoi consistent ses innombrables bienfaits sur le cerveau, mais également sur les autres fonctions vitales de notre corps ? Comment s’y retrouver parmi les multiples formes de méditation et lesquelles privilégier pour sa santé ? Comment pratiquer la méditation de A à Z ? Découvrez les pouvoirs insoupçonnés de cette discipline orientale plurimillénaire, à la fois art et thérapie : la méditation.
__________________________________________________________________________
Qu’est-ce que la méditation ?

Il s’agit d’un exercice mental qui consiste à utiliser différentes techniques de maîtrise de l’activité cérébrale.
La pratique de la méditation se divise en trois niveaux de difficulté croissante, incarnés par trois techniques de maîtrise de l’activité cérébrale.
Niveau 1 – la pleine conscience : prendre conscience du flux incessant de pensées incontrôlées qui encombrent le cerveau.
Niveau 2 – la concentration : être capable de réguler ce flux, d’orienter les pensées et de se concentrer exclusivement sur une pensée, généralement représentée par un objet ou un point spatial.
Niveau 3 – le vide mental : être en mesure de « vider » son cerveau de toute pensée. Cet état pseudo-comateux est le seul à permettre au cerveau de se mettre totalement au repos afin de se régénérer.
__________________________________________________________________________
La méditation à travers les âges et les cultures

La méditation est une discipline plurimillénaire. Elle apparaît simultanément, sous des formes différentes, au sein de nombreuses cultures et traditions religieuses ou philosophiques.
Les premières traces de l’existence de la méditation, découvertes en Asie du Sud, remontent à environ 5000 ans avant J-C. Il s’agit de peintures murales représentant des personnes assises dans des postures qui rappellent celles des yogis de la tradition hindoue.
En 1500 avant J-C, les Vedas (textes sacrés hindous) évoquent diverses pratiques méditatives, offrant au monde la première preuve écrite de l’existence de la méditation.
En Chine, à partir de -600, le taoïsme et le confucianisme (traditions philosophiques) développent différentes techniques méditatives, parallèlement au jaïnisme et au bouddhisme en Inde. Entre -500 et -200, la philosophie bouddhiste et ses pratiques méditatives vont d’ailleurs gagner l’ensemble de l’Asie.
En Grèce, environ 300 ans après J-C, plusieurs philosophes reconnaissent les bénéfices de la méditation, allant jusqu’à la mise au point de techniques méditatives basées sur la focalisation.
Entre 300 et 600, les mystiques chrétiens et musulmans (soufis) adoptent simultanément la méditation, principalement sous forme de mantras. Ils sont suivis, dans les années 1200, par les mystiques juifs (kabbale), qui développent quant à eux des techniques de méditation contemplative.
Enfin, au début du 20e siècle, plusieurs enseignants et guides spirituels indiens reconnus émigrent aux Etats-Unis, concourant à créer en Occident un engouement sans précédent pour la méditation. Depuis, il n’a jamais cessé de croître.
__________________________________________________________________________
Pourquoi pratiquer la méditation ?
Les objectifs principaux de la méditation sont les suivants :
- L’entretien ou l’amélioration de son état de santé physique et psychique

La méditation à visée médicale permet d’optimiser le fonctionnement des organes internes et des différents systèmes corporels, plus particulièrement le système nerveux (voir le détail ci-après).
Exemples de méditations à visée médicale : « zazen » et « vipassana » (technique de pleine conscience), « trataka » et « mantra » (technique de concentration), « zuowang » et « antar mouna » (technique de vide mental).
- La quête de la dimension philosophique de la vie

Plusieurs méthodes méditatives sont axées sur le placement de la conscience au centre de tous les comportements. Exemples : la conscience de l’éphémère ou de la relativité, la distanciation par rapport à l’attachement, le rejet de l’identification ou encore la prise de hauteur par rapport aux aléas de la vie.
Exemples de méditations à visée philosophique : « neti neti », « introspection », « élargissement de la conscience », « note mentale », les méditations tantriques.
- Le développement de qualités spirituelles

Certains types de méditations comportent un caractère spirituel, voire religieux. Elles permettent de renforcer sa foi ou de se rapprocher de son guide spirituel.
Exemples de méditations à visée spirituelle ou religieuse : les méditations spirituelles des mystiques de l’Islam (« Zikr », la méditation du battement de coeur, la danse des derviches soufis) et la méditation centrée sur le maître spirituel (méditation du lien d’amour).
- La cultivation des émotions positives et l’abandon des ressentiments.

Exemples de méditations axées sur la gestion des émotions : la méditation de l’amour bienveillant, la méditation orgasmique, « la paix au-delà de la douleur ».
- L’augmentation de l’amplitude respiratoire

La prise de conscience de son corps et la détente profonde qu’offre la méditation favorisent l’augmentation de la capacité pulmonaire, améliorant ainsi les fonctions respiratoires.
Exemples de méditation visant l’amélioration de la capacité respiratoire : Pranayama (régulation de la respiration), le yoga, le Qi Gong (exercices de respiration synchronisée avec de lents mouvements).
- Une meilleure connaissance de son corps

Diverses méditations proposent une reconnexion étroite à son corps via différentes techniques.
Exemples de méditations visant la connaissance de son corps : Neiguan, Kundalini (toutes deux basées sur l’exploration de ses organes internes), le yoga Nidra (basé sur le ressenti de chaque partie du corps séparément), Pranayama, Samatha (prise de conscience de la respiration).
__________________________________________________________________________
Les bienfaits de la méditation sur la santé

Sur la santé psychique :
- améliore la conscience de soi ;
- augmente la créativité ;
- améliore l’équilibre émotionnel (conscience et acceptation de ses émotions, meilleure autorégulation émotionnelle, capacité de résilience…) ;
- engendre et entretient les émotions positives ;
- favorise le lien social ;
- augmente le niveau d’empathie ;
- diminue le niveau d’anxiété chez les personnes souffrant de TAG (trouble anxieux généralisé) ;
- améliore l’état général des personnes souffrant de dépression ;
- réduit le risque de rechute chez les personnes traitées pour dépression ;
- prévient les rechutes dans le traitement des addictions ;
- favorise le calme intérieur et la sérénité ;
- augmente la compassion et la bienveillance ;
- réduit le niveau de stress perçu ;
- favorise l’adaptation au stress aigu (lié à un facteur extérieur) ;
- diminue les symptômes du stress chronique.
Sur la santé physiologique :
- agit positivement sur le syndrome métabolique (état caractérisé par la présence de risques cardiovasculaires et une résistance à l’insuline) ;
- augmente la tolérance au glucose et la sensibilité à l’insuline ;
- réduit la tension artérielle ;
- réduit l’inflammation chronique ;
- favorise l’oxygénation des poumons et sa diffusion à travers le corps jusqu’au cerveau ;
- l’oxygénation optimale du corps réduit la production de déchets ;
- procure un sommeil plus réparateur et réduit le besoin de sommeil ;
- réduit les symptômes de la douleur chronique et régule la sensibilité à la douleur ;
- favorise la résorption des problèmes de peau (psoriasis, eczéma…) ;
- agit favorablement sur le système hormonal ;
- ralentit le vieillissement cellulaire ;
- améliore le fonctionnement du système cardiovasculaire ;
- renforce le système immunitaire.
Sur la santé cognitive :
N.B. : les observations suivantes sont basées sur plusieurs recherches réalisées par imagerie médicale, ciblant les modifications des différentes régions cérébrales suite à la pratique régulière de la méditation.
- engendre un épaississement de la matière grise dans certaines régions clés du cerveau (contrôle de l’attention, de la perception…) ;
- génère une augmentation du nombre de connexions entre les deux hémisphères cérébraux ;
- favorise le développement de nouveaux réseaux neuronaux ;
- augmente la rapidité de traitement des informations ;
- améliore la capacité de concentration ;
- améliore la capacité d’inhibition des comportements inappropriés ;
- favorise la créativité ;
- préserve, voire renforce la mémoire à court et long termes ;
- améliore la capacité d’apprentissage ;
- prévient la maladie d’Alzheimer.
Conclusion :
Il est avéré que la pratique d’environ vingt minutes par jour de méditation pendant minimum huit semaines engendre des modifications de la structure cérébrale et une amélioration globale du fonctionnement du cerveau, tant au niveau des performances cognitives que de l’équilibre émotionnel.
Non seulement la méditation est-elle une discipline d’entretien du corps et de l’esprit, mais elle accélère également leurs processus d’autoréparation. La méditation constitue donc un élément essentiel de la prévention et du traitement des pathologies physiologiques et des troubles psychiques.
__________________________________________________________________________
La méditation en milieu hospitalier

N.B. : « Pleine conscience » est le terme laïque employé en milieu hospitalier pour désigner la méditation. D’ailleurs, l’une des deux méditations traditionnelles de base, Vipassana, signifie « clairvoyance » ou « pleine conscience » en sanskrit (voir le point « Quelle méditation choisir et comment la pratiquer »).
- La thérapie de réduction du stress fondée sur la pleine conscience (« méthode MBSR » en anglais) : mise au point dans les années 1970, cette thérapie médicale destinée aux patients souffrant de troubles psychosomatiques consiste en une « cure » de méditation de trente minutes par jour durant huit semaines. La méthode MBSR entraîne la régression observable de pathologies telles que la dépression, le trouble anxieux généralisé, les maladies de peau (psoriasis, eczéma…), l’hypertension et la douleur chronique. La méthode MBSR est pratiquée dans plus de 500 hôpitaux et cliniques aux Etats-Unis et pas moins de 700 dans le monde. De plus, la Sécurité sociale britannique prend en charge la thérapie par MBSR.
- La thérapie cognitive basée sur la pleine conscience (« méthode MBCT » en anglais) : la méthode MBCT est une méthode similaire à la précédente, mais utilisée exclusivement dans le cadre de la lutte contre la rechute des patients souffrant de dépression. Plus de 200 hôpitaux américains incluent la méthode MBCT dans le traitement des états dépressifs.
- En France, l’hôpital parisien Sainte-Anne propose des cours de méditation laïque à visée strictement médicale.
- En Belgique, le dr. Steven Laureys, éminent neurologue, prescrit des séances de méditation à ses patients souffrant d’anxiété, dépression, douleurs chroniques ou insomnie.
__________________________________________________________________________
Quelle(s) méditation(s) choisir selon son niveau et ses objectifs ?

Quel type de méditation pour les débutants ?
La méditation de pleine conscience.
Qu’est-ce que la pleine conscience ?
La pleine conscience consiste à utiliser ses sens pour prendre conscience de son corps, sa respiration, son environnement, etc.
Quelles sont les principales méditations de pleine conscience ?
- Zazen,
- Vipassana.
N.B. : Vipassana est une version plus complète et aboutie de Zazen. Il est donc préférable de s’initier à la démarche de prise de conscience à travers Zazen avant d’atteindre la pleine conscience avec Vipassana.
La méditation « Zazen »

Traduction du sanskrit : méditation assise (« za » = « assis » ; « zen » = méditation)
Tradition : bouddhisme
Objectif : développer sa conscience de l’instant présent et devenir l’observateur du flux de ses pensées.
Pour des effets bénéfiques sur la santé : séances de min. 20 minutes d’affilée, pratiquées plusieurs fois par semaine.
Pour des changements d’ordre spirituel : séances de min. 40 minutes d’affilée, pratiquées plusieurs fois par semaine.
Pratique par étapes : voir « COMMENT PRATIQUER LES MEDITATIONS DE NIVEAU DEBUTANT »
———————————————————————————————————
La méditation Vipassana

Traduction du pali : « clairvoyance », « vision profonde » (ou pleine conscience)
Tradition : bouddhisme
Objectif : atteindre la pleine conscience de ses pensées et sensations corporelles.
Pour des effets bénéfiques sur la santé : séances de min. 20 minutes d’affilée, pratiquées plusieurs fois par semaine.
Pour des changements d’ordre spirituel : séances de min. 40 minutes d’affilée, pratiquées plusieurs fois par semaine.
Pratique par étapes : voir « COMMENT PRATIQUER LES MEDITATIONS DE NIVEAU DEBUTANT »
Quel type de méditation pour les pratiquants de niveau intermédiaire ?
La méditation de concentration (ou de focalisation).
Quelles sont les principales méditations de concentration ?
- Mantra,
- Trataka.
N.B. : il est recommandé de commencer sa pratique par Mantra. En effet, Trataka constitue le prolongement de Mantra. La concentration visuelle, plus ardue à maintenir, prend le relais de la concentration par répétition mentale.
La méditation « Mantra »

Traduction du sanskrit : « pensée qui protège » ou « instrument pour penser » (« man » = penser ; « tra » = « qui protège » ou encore « instrument »).
Traditions : yoga, Veda
Objectif : induire un retour au calme et à la stabilité intérieure.
Pour des effets bénéfiques sur la santé : séances de min. 20 minutes d’affilée, pratiquées plusieurs fois par semaine.
Pour des changements d’ordre spirituel : séances de min. 40 minutes d’affilée, pratiquées plusieurs fois par semaine.
Pratique par étapes : voir « COMMENT PRATIQUER LES MEDITATIONS DE NIVEAU INTERMEDIAIRE »
——————————————————————————————————–
Trataka

Traduction du sanskrit : « concentration oculaire » (« tratak » = regarder)
Tradition : yoga
Objectif : développer sa capacité de concentration et atteindre un profond apaisement mental.
Pour des effets bénéfiques sur la santé : séances de min. 20 minutes d’affilée, pratiquées plusieurs fois par semaine.
Pour des changements d’ordre spirituel : séances de min. 40 minutes d’affilée, pratiquées plusieurs fois par semaine.
Avertissement : si vous souffrez d’épilepsie, de troubles visuels (myopie, astigmatisme) et/ou de pathologies oculaires (glaucome, cataracte), privilégiez un objet non lumineux. Par ailleurs, celui-ci doit être de nature neutre, c’est-à-dire ne générer aucun sentiment particulier. Tout comme dans l’utilisation de la bougie, un faible éclairage de la pièce favorisera la concentration sur cet objet.
Pratique par étapes : voir « COMMENT PRATIQUER LES MEDITATIONS DE NIVEAU INTERMEDIAIRE »
Quel type de méditation pour les pratiquants de niveau avancé ?
La méditation par le vide mental.
Qu’est-ce que le vide mental ?
Comme son nom l’indique, il s’agit de « se vider » le cerveau, c’est-à-dire suspendre toute activité cérébrale pour plonger dans le vide insondable de la conscience. En d’autres termes, le vide mental est l’art de se libérer de soi-même.
Quelles sont les principales médiations par le vide mental ?
- Antar Mouna,
- Zuowang.
Antar Mouna

Traduction du sanskrit : silence intérieur (« antar » = « intérieur » ; « mouna » = « silence »).
Tradition : yoga
Objectif : récapituler les exercices précédents (pleine conscience et concentration) avant d’introduire le vide mental. Il s’agit d’un exercice préliminaire à Zuowang, méditation totalement axée sur le vide mental.
Pour des effets bénéfiques sur la santé : séances de min. 20 minutes d’affilée, pratiquées plusieurs fois par semaine.
Pour des changements d’ordre spirituel : séances de min. 40 minutes d’affilée, pratiquées plusieurs fois par semaine.
Pratique par étapes : voir « COMMENT PRATIQUER LES MEDITATIONS DE NIVEAU AVANCE ».
———————————————————————————————————
Zuowang

Traduction du sanskrit : « Assis dans l’oubli »
Tradition : taoïsme
Objectif : faire disparaître toute pensée de l’esprit et se détacher du « moi ».
Pour des effets bénéfiques sur la santé : séances de min. 20 minutes d’affilée, pratiquées plusieurs fois par semaine.
Pour des changements d’ordre spirituel : séances de min. 40 minutes d’affilée, pratiquées plusieurs fois par semaine.
Pratique par étapes : voir « COMMENT PRATIQUER LES MEDITATIONS DE NIVEAU AVANCE »
Comment pratiquer les méditations de niveau débutant
La méditation « Zazen »

Pratique par étapes :
- Asseyez-vous en tailleur en maintenant le dos droit. Les yeux sont entrouverts, regard orienté vers le sol ou un mur.
- Lorsqu’une pensée surgit, prenez conscience de sa présence sans pour autant porter de jugement sur cette pensée.
- Ne tentez pas d’éliminer les pensées qui se succèdent dans votre esprit ou d’empêcher leur surgissement.
- Pendant plusieurs minutes d’affilée, ne subissez pas vos pensées, observez-les. Eveillez votre conscience.
- Durant la séance, tâcher de n’émettre ni souhait, ni attente, ni intention. Le Zazen n’a pour objectif que la prise de conscience de soi-même et de son environnement. Demeurez immobile, ancré-e dans l’instant présent.
- Maintenez aussi longtemps que possible cet état de vigilante observation de l’instant présent. Lorsque vos pensées vous submergent, que la distraction ou la somnolence vous gagne, ouvrez les yeux et bougez lentement pour sortir de Zazen.
La méditation Vipassana

Pratique par étapes :
- Asseyez-vous en tailleur sur un tapis de sol ou un canapé et fermez les yeux.
- Commencez par prêter attention à votre respiration : inspirez lentement et profondément par le nez, puis expirez par la bouche. Prenez conscience du passage de l’air par les narines, du soulèvement abdominal, puis du relâchement de la poitrine.
- Mettez-vous à la recherche de sensations corporelles : chaleur ou fraîcheur, détente ou raideur, confort ou compression des chairs par les vêtements, légèreté ou lourdeur, éventuelles douleurs musculaires ou articulaires… Observez chaque sensation rencontrée en vous gardant de l’analyser, la juger ou tenter d’y échapper.
- Identifiez votre état d’esprit actuel. Pour ce faire, associez-lui mentalement 2 à 5 adjectifs, qui mesureront la profondeur de votre plongée en vous-même.
- Enfin, portez votre attention sur vos pensées. Observez leur caractère éphémère : elles surgissent, se déploient avant de disparaître, formant un flux incessant dans votre esprit.
- Tout comme dans le Zazen, ne vous laissez pas emporter par vos pensées, sans pour autant les rejeter. Prenez conscience de leur passage et observez leur nature.
- Maintenez aussi longtemps que possible cet état de vigilante observation de l’instant présent. Lorsque vos pensées vous submergent, que la distraction ou la somnolence vous gagne, ouvrez les yeux et bougez lentement pour sortir de Vipassana.
Comment pratiquer les méditations de niveau intermédiaire
La méditation « Mantra »

Pratique par étapes :
- Avant tout, choisissez votre mantra. Il s’agit d’un mot ou d’une phrase qui revêt une signification particulière à vos yeux. Exemple : le célèbre mantra « om » signifie « je m’exprime » en sanskrit. Il permet d’ouvrir le chakra de la gorge chez les personnes trop introverties.
- Asseyez-vous en tailleur, maintenez la tête et le dos droits et rejetez les épaules en arrière pour dégager la poitrine. A trois reprises, inspirez lentement et profondément par le nez en gonflant le ventre, puis le diaphragme, avant d’expirer lentement par la bouche.
- Une fois la détente induite, fermez les yeux et prononcez votre mantra à voix haute, puis répétez-le durant trois minutes.
- Les yeux toujours fermés, répétez à présent le mantra à voix basse et en ralentissant votre débit. Le murmure et la lenteur présentent un effet hypnotique qui détend le système nerveux.
- Lorsque vous sentez le calme revenir en vous, passez à la répétition mentale de votre mantra. Si la somnolence vous gagne, ouvrez les yeux tout en évitant la fixation visuelle.
- A chaque étape, centrez votre attention sur le son du mantra, audible ou mental. Chassez les pensées qui tentent de s’immiscer entre vous et votre mantra. Ne répétez pas ce dernier machinalement, mais en lui imprimant l’intention qui lui est associée.
- Maintenez cet état de concentration aussi longtemps que possible. Enfin, bougez lentement pour sortir de Mantra.
La méditation « Trataka »

Pratique par étapes :
- Organisez votre espace : tirez les rideaux ou baissez les volets pour obtenir la pénombre. Choisissez un emplacement confortable (fauteuil ou canapé). Posez une bougie allumée sur un support (idéalement un tabouret) placé à environ 50 cm de vous, à hauteur des yeux.
- A trois reprises, les yeux fermés, inspirez lentement et profondément par le nez en gonflant le ventre puis le diaphragme, avant d’expirer lentement par la bouche.
- Une fois la détente induite, ouvrez les yeux et posez-les sur la flamme de la bougie. Centrez-y toute votre attention. Si vous sentez la distraction vous gagner ou vos yeux se fatiguer, fermez-les quelques minutes. Durant cette pause, concentrez-vous sur les halos colorés se mouvant sur l’écran noir de vos paupières closes.
- Lorsque vous sentez vos yeux suffisamment reposés, reprenez votre exercice de fixation visuelle. Concentrez-vous sur la flamme comme si seule cette bougie existait au monde.
- Le plus longtemps possible, maintenez cet état de concentration où regard et esprit se rejoignent. Lorsque vos pensées vous submergent, que la distraction ou la somnolence vous gagne, ouvrez les yeux et bougez lentement pour sortir de Trataka.
Comment pratiquer les méditations de niveau avancé
La méditation « Antar Mouna »

Pratique par étapes :
- Asseyez-vous dans une position propice à la concentration (idéalement, en tailleur). Commencez par vous rassembler : prenez plusieurs inspirations lentes et profondes par le nez, en gonflant le ventre puis le diaphragme, avant d’expirer lentement par la bouche.
- Prêtez attention aux bruits qui vous entourent, sans pour autant les analyser. Ensuite, balayez vos sensations corporelles, de la tête au pieds, sans leur porter de jugement. Enfin, prenez conscience des mouvements de votre respiration.
- Concentrez-vous sur les pensées qui défilent dans votre tête. Choisissez une pensée positive et focalisez votre attention sur elle. Eliminez toute pensée venant interférer avec elle.
- Développez cette pensée durant environ une minute, puis faites-la disparaître de votre esprit. Il ne doit rester en vous qu’un grand espace intérieur libéré de tout son et de toute image : la conscience.
- Faites resurgir votre pensée : concentrez-vous à nouveau sur elle pendant une minute avant de l’effacer. Faites cet exercice trois fois en tout. Il s’agit d’un exercice de « musculation » de la concentration, visant à introduire le vide mental.
- Lorsque votre esprit se « vide » pour la troisième fois, maintenez-vous dans cet état le plus longtemps possible, de quelques secondes (en début de pratique) à une vingtaine de minutes (à un niveau avancé). Ainsi, le vide mental est une méthode permettant l’accession prolongée à votre conscience.
- Revenez à votre état initial en ouvrant les yeux et en bougeant lentement.
La méditation « Zuowang »

Pratique par étapes :
- Asseyez-vous le dos droit et non soutenu, pour favoriser la concentration et la stabilité mentales. Fermez les yeux. A trois reprises, prenez une inspiration lente et profonde par le nez en gonflant le ventre puis le diaphragme, avant d’expirer lentement par la bouche.
- Après avoir appris à prendre conscience de votre corps et environnement à travers les précédentes méditations, vous êtes en mesure de vous en libérer dans la méditation ultime. De même, à présent que vous êtes capable de vous concentrer sur votre conscience, vous pouvez vous y plonger : oubliez tout. Oubliez les bruits environnants, jusqu’à l’endroit où vous vous trouvez ; oubliez vos sensations corporelles, jusqu’à votre forme ; oubliez vos pensées, vos (res)sentiments, vos goûts, vos envies, vos jugements, jusqu’à l’identité que vous vous êtes créée.
- Demeurez dans cette immobilité physique autant que mentale. Maintenez votre cerveau déconnecté du monde extérieur comme de votre monde intérieur. Cet état de « non-action » cérébrale constitue le plus haut niveau de régénération du cerveau. Il s’agit de l’état pseudo-comateux atteint par les moines bouddhistes lors de leurs méditations profondes.
- Maintenez cet état de vide mental le plus longtemps possible. Lorsque la distraction vous gagne, ouvrez les yeux et bougez lentement pour sortir de Zuowang.
N.B. : au début de votre pratique, vous ne pourrez probablement maintenir cet état de déconnexion mentale que quelques dizaines de secondes. Toutefois, une pratique régulière vous permettra de maîtriser votre activité cérébrale assez longtemps pour en observer les effets bénéfiques sur votre santé.
Notre esprit est comme l’eau : lorsqu’il est trouble, il est impossible de voir clairement au travers. La méditation rend notre esprit limpide comme l’eau pure, pour nous aider à y voir clair en nous-mêmes.
Me. Shi Heng Yi (auteur)