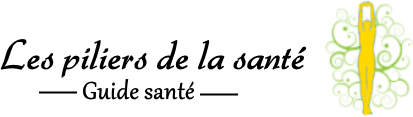Introduction
Le sommeil est un élément essentiel de notre vie.
En effet, nous passons un tiers de notre temps au lit. Dormir est aussi nécessaire à notre survie que se nourrir et s’hydrater.
Le sommeil joue un rôle prépondérant dans les mécanismes d’apprentissage, de mémorisation et de concentration. Il participe au bon fonctionnement de tous les organes du corps (cerveau, cœur, poumons…), du métabolisme et du système immunitaire.
Il est établi qu’un déficit de sommeil augmente fortement les risques de développer des pathologies cardiovasculaires, mais également le diabète, la dépression ou l’obésité. Pourtant, la fréquence des troubles du sommeil a significativement augmenté ces dernières décennies.

Selon une enquête de l’Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV), 36 % des Français déclarent souffrir d’au moins un trouble du sommeil (insomnie, apnée du sommeil…). De plus, le sommeil des Français s’avère de mauvaise qualité : 73 % d’entre eux déclarent se réveiller au moins une fois par nuit environ trente minutes. Conséquence : 25 % d’entre eux reconnaissent se sentir somnolents durant la journée. Un constat inquiétant…
__________________________________________________________________________
Qu’est-ce que le sommeil ?
Le sommeil est la meilleure des méditations.
Le Dalaï Lama
Le sommeil correspond à une baisse de l’état de conscience qui sépare deux périodes d’éveil. Il est caractérisé par de nombreuses modifications physiologiques : sécrétion d’hormones spécifiques, perte de la vigilance, diminution du rythme cardiaque, du tonus musculaire, de la température corporelle.
__________________________________________________________________________
Les mécanismes du sommeil
Nos états d’éveil et de sommeil sont régis par l’interaction de deux mécanismes biologiques internes : le rythme circadien et l’homéostasie.
Le rythme circadien
Il s’agit d’un rythme biologique d’environ 24 heures qui détermine l’alternance veille-sommeil en l’absence de repères temporels. Au cours de ces 24 heures, le rythme circadien positionne les moments favorables à l’éveil et au sommeil.
Le rythme circadien régit un grand nombre de fonctions : la température corporelle, le métabolisme, la libération des hormones, etc. (voir schéma ci-dessous).


L’homéostasie
Le processus homéostatique a pour fonction la régulation de notre besoin de sommeil. L’homéostasie est définie par l’augmentation de notre besoin de sommeil au cours de la journée, en fonction de notre temps de veille : plus longtemps on reste éveillé, plus on a besoin de sommeil. C’est également le processus homéostatique qui intervient dans la sensation de somnolence : celle-ci nous indique que notre besoin de sommeil n’a pas été satisfait durant la nuit ou que la période de veille précédant le sommeil a duré trop longtemps.
__________________________________________________________________________
Les bienfaits d’un sommeil réparateur

Même une âme immergée dans le sommeil aide à faire quelque chose du monde.
Héraclite
Les mécanismes complexes et les rôles multiples du sommeil peuvent être synthétisés en un mot : « régénération ».
Le sommeil est dit réparateur car il « répare » les incidents physiques (inflammation, blessure…) ou psychologiques (contrariété, tristesse, colère) de la journée.
Le sommeil réparateur favorise la récupération physique et intellectuelle :
- Il renforce le système immunitaire : il augmente l’efficacité des globules blancs, indispensables à la lutte contre les infections.
- Il permet d’épargner de l’énergie : durant le sommeil, la consommation en oxygène diminue, le rythme cardiaque ralentit, la température corporelle baisse…
- Il favorise le renouvellement cellulaire : notre organisme profite de cette phase de repos pour intensifier le renouvellement des cellules des os, des muscles et de la peau.
- Il permet la mise au repos de notre système cardiovasculaire. Conséquence principale : baisse de la tension artérielle.
- Il régule nos humeurs : un sommeil réparateur permet d’éviter les troubles de l’humeur (irritabilité, morosité…).
- Il permet l’évacuation des tensions musculaires : durant cet état, les muscles ne sont pas sollicités.
- Il maintient la synchronisation de notre horloge biologique : celle-ci gère notamment les variations de températures, la sécrétions d’hormones et les rythmes du sommeil.
- Il régule notre appétit : le manque de sommeil augmente la sensation de faim et la tendance à consommer des aliments caloriques.
- Il accélère la cicatrisation des blessures et participe à la réduction de l’inflammation.
- Il permet au cerveau de restaurer ses capacités d’apprentissage, mémorisation et concentration : le sommeil contribue à la régénération des connexions cérébrales.
- Il augmente notre niveau d’énergie et de vitalité au quotidien.
__________________________________________________________________________
Les troubles du sommeil, qu’est-ce que c’est ?

Un esprit chiffonné fait un oreiller agité.
Charlotte Brontë (poétesse et romancière britannique)
Les troubles du sommeil sont des phénomènes perturbant la durée, la qualité ou le déroulement du sommeil, entraînant des conséquences sur l’état de santé.
Les nombreuses enquêtes et études sur le sommeil démontrent qu’environ 30 % des Français adultes souffrent de troubles du sommeil.
__________________________________________________________________________
Les différents types de troubles du sommeil
Les troubles du sommeil sont classés en trois catégories :
Les dyssomnies
Troubles du sommeil qui affectent la durée ou la qualité du sommeil (insomnie, troubles du rythme circadien, narcolepsie, hypersomnie).
Les parasomnies
Ensemble de comportements anormaux durant le sommeil, sans conséquences sur l’état d’éveil (apnées du sommeil, somnambulisme, bruxisme nocturne, troubles du comportement en sommeil paradoxal).
Les troubles du sommeil d’origine psychiatrique
Perturbations du sommeil liées à un dérèglement d’ordre neurologique (dépression, troubles de l’anxiété).
Tableau comparatif des différents types de troubles du sommeil
| Dyssomnies | Parasomnies | Troubles d’origine psychiatrique |
| Insomnie (voir le point suivant) | Apnées du sommeil : arrêts involontaires de la respiration pendant quelques secondes durant le sommeil. | Dépression : trouble de l’humeur caractérisé par un sentiment de désespoir, de profonde tristesse, un repli sur soi et une perte de motivation et d’intérêt pour les activités de la vie quotidienne. |
| Troubles du rythme circadien : désynchronisation entre les rythmes de sommeil-veille internes et le cycle lumière-obscurité | Somnambulisme : épisodes d’activités motrices alors que le dormeur est inconscient. | |
| Narcolepsie : tendance à s’endormir durant de façon intempestive | Bruxisme nocturne : grincement ou serrement des dents durant le sommeil. | Troubles de l’anxiété (voir le point « Les causes de l’insomnie chronique ») |
| Hypersomnie : sommeil anormalement prolongé ou survenant trop fréquemment | Troubles du comportement en sommeil paradoxal : mouvements parfois brusques du dormeur, causés par ses rêves durant la phase de sommeil paradoxal. |
__________________________________________________________________________
L’insomnie, trouble du sommeil le plus fréquent

Qu’est-ce que la nuit a à voir avec le sommeil ?
John Milton (poète et pamphlétaire britannique)
La dyssomnie la plus fréquente est l’insomnie. En effet, 13 % des Français (17 % de femmes et 9 % d’hommes) déclarent souffrir d’insomnie chronique, le type d’insomnie le plus sévère (voir point suivant).
L’insomnie se définit comme une difficulté persistante à l’endormissement et au maintien du sommeil. L’insomnie est caractérisée par :
- des difficultés d’endormissement ;
- un ou plusieurs réveils nocturnes ;
- un réveil matinal précoce.
Ces perturbations du sommeil sont accompagnées d’une sensation de sommeil non réparateur, ayant pour conséquence une dégradation de l’état de santé.
__________________________________________________________________________
Les différents types d’insomnie
L’insomnie est un terme sophistiqué pour désigner les pensées que l’on a oublié d’avoir dans la journée.
Alain de Botton (philosophe britannique)
L’insomnie transitoire
Ce type d’insomnie est dit « d’ajustement ». De courte durée, il est en lien direct avec un événement ponctuel générateur de stress ou d’anxiété (déménagement, perte d’emploi, période d’examens, etc.).
L’insomnie à moyen terme
L’état d’insomnie dure depuis plus de trois semaines, mais moins de trois mois. Il se situe à un stade où les choses peuvent encore rentrer dans l’ordre.
L’insomnie chronique
Il s’agit d’une insomnie survenant plus de trois fois par semaine, depuis plus de trois mois. Ce type d’insomnie est donc défini comme une difficulté récurrente d’endormissement et/ou de maintien du sommeil.
__________________________________________________________________________
Quand poser un diagnostic d’insomnie chronique ?

Un diagnostic d’insomnie chronique peut être posé si les symptômes de l’insomnie surviennent au moins trois fois par semaine depuis plus de trois mois.
Les deux premiers types d’insomnie étant passagers et sans conséquences majeures pour la santé, nous allons nous intéresser aux causes et traitements du troisième type d’insomnie : l’insomnie chronique.
__________________________________________________________________________
Les causes de l’insomnie chronique
Le sommeil est comme un chat : il ne vient à vous que lorsque vous l’ignorez.
Gillian Flynn (scénariste et romancière américaine)
Cause n°1 : le stress chronique

Qu’est-ce que le stress ?
Le stress désigne une réponse psychologique mise en place par l’organisme pour réagir de façon adaptée à toute agression physique ou psychologique.
Les différents types de stress
Le stress peut prendre différentes formes :
Le stress aigu (à court terme)

Il s’agit d’un stress à court terme, qui accompagne généralement des épisodes de panique ou de peur intense (prise de conscience d’un oubli important, accident de la route, etc.).
Symptômes du stress aigu : hausse de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle, sentiment d’anxiété et/ou d’irritabilité. Fréquemment : problème gastro-intestinaux, maux de tête, maux de dos, etc.
Les symptômes du stress aigu disparaissent au terme d’une courte période.
Le stress épisodique (à moyen terme)

Il s’agit d’une accumulation de moments de stress aigu. Les personnes vivant en situation précaire (difficultés pécuniaires, maladie chronique…) sont particulièrement exposées au stress épisodique. De plus, elles auront tendance à développer un état dépressif ou à se tourner vers des dérivatifs tels que l’alcool ou la suralimentation, facteurs d’aggravation de l’insomnie.
Le stress chronique (à long terme)

Lors d’une situation génératrice de stress, l’organisme libère une hormone appelée cortisol. Si le corps ne se détend pas entre deux facteurs de stress, le taux de cortisol reste élevé. Par conséquent, la personne souffre d’un état de stress permanent: c’est le stress chronique. Cet état engendre de multiples conséquences négatives pour la santé physique et psychique.
Cette forme grave de stress trouve généralement son origine dans une situation traumatique survenue dans l’enfance ou l’adolescence (décès d’un parent, abandon, pauvreté extrême, maltraitance physique, sexuelle ou psychologique…). Les personnes victimes de ces événements traumatiques ont tendance à intérioriser leur souffrance et leur désarroi. Ce comportement mène, à long terme, à un épuisement mental se traduisant par l’impossibilité de se détendre.
Les conséquences du stress chronique sur le sommeil
La persistance d’un état de stress engendre de multiples problèmes de santé qui ont des répercussions sur l’endormissement et la qualité du sommeil. En effet, le stress chronique affecte tous les systèmes de l’organisme.
Les effets du stress sur le système cardiovasculaire

Le stress aigu (à court terme) provoque une réponse biologique de l’organisme appelée « fuite ou combat ». Cet état se caractérise par l’augmentation de la fréquence cardiaque, la hausse de la tension artérielle et la puissance des contractions des muscles cardiaques. Pour réguler ces fonctions, du cortisol et de l’adrénaline (hormones de la réponse au stress) sont libérés. Durant un épisode de stress aigu, ces modifications biologiques sont transitoires.
En cas de stress chronique, l’organisme génère ces réponses biologiques en continu pour s’adapter à un stress devenu permanent.
Risques à long terme : troubles cardiovasculaires, hypertension, crise cardiaque, inflammation du système circulatoire, accident vasculaire cérébral, etc.
Les effets du stress sur le système respiratoire

Une situation de stress aigu provoque une respiration accélérée pouvant aller jusqu’à l’essoufflement.
Le stress chronique modifie le rythme respiratoire, ce qui favorise le développement des troubles liés à une respiration inadaptée.
Risques à long terme : asthme, céphalées, maladie pulmonaire obstructive chronique, etc.
Les effets du stress sur le système nerveux

Dans un épisode de stress aigu, la production de cortisol et d’adrénaline (hormones de la réponse au stress) est induite dans le système nerveux par des signaux entre les glandes surrénales et l’hypophyse. C’est également le système nerveux qui permet le retour au calme après une situation stressante.
Le stress chronique provoque une altération du fonctionnement du système nerveux, ce qui engendre une surcharge nerveuse.
Risques à long terme :
- vieillissement prématuré de l’organisme ;
- insomnie chronique.
Les effets du stress sur le système gastro-intestinal

Le stress affecte la communication entre les bactéries intestinales et le cerveau, qui assure le bon fonctionnement des organes internes. Cette interférence peut entraîner un inconfort gastro-intestinal (douleurs, ballonnements…), une perte d’appétit ou au contraire, une suralimentation. De plus, le stress contribue à la fragilisation des barrières intestinales qui empêchent la pénétration des bactéries pathogènes dans l’estomac. L’intrusion de ces bactéries est à l’origine de nombreuses pathologies chroniques.
Risques à long terme :
- développement et aggravation de maladies chroniques inflammatoires ;
- insomnie chronique.
Les effets du stress sur le système musculosquelettique

Dans un moment stressant, les muscles se contractent. Il s’agit d’un mouvement réflexif destiné à protéger le corps de la douleur d’une potentielle agression.
Le stress chronique engendre des tensions musculaires persistantes, qui peuvent être à l’origine de multiples douleurs.
Risques à long terme :
- migraines ;
- douleurs des membres supérieurs ;
- douleurs au bas du dos ;
- insomnie chronique.
Les effets du stress sur le système reproducteur

Dans notre mémoire génétique, un état de stress chronique est lié à un environnement hostile et dangereux, par conséquent non propice à la reproduction. C’est pourquoi la personne souffrant de stress chronique ressent une diminution du désir sexuel. De plus, une femme éprouvera plus de difficulté à tomber enceinte, tandis qu’un homme souffrira d’une diminution de la taille et des performances de ses spermatozoïdes.
En cas de grossesse, le stress chronique peut en outre affecter le développement du fœtus. Par ailleurs, il augmente la vulnérabilité aux maladies touchant le système reproducteur.
Le cercle du stress

Le stress chronique fait grimper le taux de cortisol (hormone du stress).
Un taux de cortisol élevé affecte le fonctionnement de l’hippocampe, détériorant les capacités de perception, d’apprentissage, de mémorisation et de concentration.
Ces mauvaises performances engendrent des troubles du sommeil et une fragilité émotionnelle, qui mènent à un état de stress ancré.
Comment briser le cercle du stress ?
Dans la partie « Comment retrouver un sommeil réparateur », vous découvrirez différentes méthodes naturelles pour vaincre le stress et les épisodes d’insomnie qui en découlent.
Cause n° 2 : les troubles anxieux

Qu’est-ce que l’anxiété ?
L’anxiété est un sentiment d’inquiétude, d’incertitude et de malaise, justifié par une situation stressante ou effrayante.
Qu’est-ce qu’un trouble anxieux ?
Il s’agit d’une anxiété survenant alors qu’aucun facteur extérieur ne la justifie réellement. Les troubles de l’anxiété sont caractérisés par des sentiments de peur et de détresse disproportionnés par rapport aux événements.
Les différents types de troubles anxieux
Trouble anxieux généralisé (TAG)

Le T.A.G. se caractérise par une inquiétude excessive, persistante et incontrôlable concernant différents domaines tels que vie familiale, vie professionnelle, santé ou finances. Bien que cette anxiété soit sans lien avec une menace réelle, la personne souffrant de T.A.G. n’est pas en mesure de se raisonner ou de maîtriser ses émotions. Cette anxiété « flottante » affecte significativement la qualité de vie.
Trouble d’anxiété sociale

Il s’agit d’une anxiété intense ressentie en société : sur le lieu de travail, lors d’une réunion familiale, dans une fête ou une réception… La cause de cette anxiété réside dans l’anticipation de comportements malveillants de la part d’autrui (jugement négatif, critiques, rejet, humiliation…), mais également la crainte de déplaire, offenser ou encore se ridiculiser.
Phobie spécifique

Sentiment d’anxiété surgissant à la seule perspective de se trouver dans une situation particulière ou d’être en présence d’un objet spécifique. Cette anxiété se mue en peur intense en présence de la situation ou de l’objet redouté. Par ailleurs, cette peur est quasiment toujours disproportionnée par rapport à la menace encourue. Exemples de phobies spécifiques concernant une situation : agoraphobie (peur de quitter son domicile et des espaces ouverts en général), claustrophobie (peur des espaces clos), acrophobie (peur des endroits en hauteur). Exemples de phobies spécifiques concernant un objet : phobie des insectes, de certains animaux, des orages, des blessures.
Trouble panique

Il s’agit d’attaques de panique, dont les principaux symptômes sont des sentiments d’effroi et de désarroi, une forte transpiration et une accélération cardiaque. La durée moyenne d’une attaque de panique est de quelques minutes.
Trouble obsessionnel-compulsif (TOC)

Le T.O.C. se caractérise par l’apparition d’une pensée persistante et récurrente (obsession), qui engendre de l’inquiétude ou de la peur. Cette anxiété fait naître le besoin d’effectuer un acte ritualisé (compulsion) dont le but consiste à atténuer l’anxiété causée par l’obsession.
Mutisme sélectif

Ce trouble se caractérise par une incapacité à s’exprimer au sein d’un groupe ou dans des situations où la participation de chacun est requise. Le mutisme sélectif provient d’une appréhension à être le centre de l’attention et à s’exposer, par cette position, à un éventuel jugement négatif de la part des autres membres du groupe.
Trouble d’anxiété de séparation

Il s’agit d’une anxiété générée par une situation dans laquelle le sujet se trouve momentanément séparé d’une figure d’attachement. Cette anxiété est due à la peur irrationnelle que l’on porte atteinte à la figure d’attachement ou que celle-ci disparaisse irrémédiablement.
Les effets des troubles anxieux sur la santé
Effets psychosomatiques (conséquences du stress sur l’organisme)
- Pathologies cardiovasculaires : tachycardie (rythme cardiaque trop rapide), hypertension artérielle, augmentation des risques de décès suite à une crise cardiaque, accident vasculaire cérébral (AVC).
- Affaiblissement du système immunitaire : inflammation chronique généralisée de l’organisme, faible résistance face aux virus (rhumes fréquents, etc.).
- Troubles digestifs : dyspepsie fonctionnelle (maux d’estomac), reflux gastro-oesophagiens, constipation, diarrhée, crampes abdominales, nausées régulières, syndrome du côlon irritable.
- Troubles respiratoires : essoufflement, oppression thoracique (avec ou sans douleur), asthme, asthme nocturne, asthme induit par l’exercice physique, aggravation des maladies pulmonaires obstructives.
- Troubles de l’audition : acouphènes, sensation d’oreilles bouchées ou de « boule de coton » dans une ou les deux oreilles, pression à l’intérieur des oreilles.
- Troubles de la vision : vision floue apparentée à la myopie, vision « flottante » (les contours des objets semblent « flotter »), vision « sautante » (incapacité à se concentrer sur un objet car le regard « saute »), modification des couleurs (plus intenses ou plus ternes), scintillement des couleurs, pertes momentanées de la vision.
- Troubles du sommeil : difficultés d’endormissement, sommeil agité, réveils nocturnes, somnambulisme, sommeil non réparateur…
- Troubles cognitifs : pertes momentanées de la mémoire à court terme (incapacité à se rappeler des tâches effectuées quelques heures plus tôt), difficultés de concentration, distraction (oublis fréquents, erreurs…), altération de la capacité d’apprentissage.
- Douleurs chroniques : migraines/céphalées régulières, tensions ou crispations musculaires, douleurs articulaires, douleurs maxillaires (des mâchoires), sensation de brûlure oculaire, avec rougeur et démangeaisons, sensation de « chocs électriques » sur certaines parties du corps (crâne, colonne vertébrale…), sensation de « coupures » sur la peau.
- Perturbations au niveau buccal : augmentation du taux d’acidité dans la bouche, provoquant la récession gingivale (rétractation des gencives), goût métallique ou sucré dans la bouche, sécheresse buccale (boire de l’eau n’apportant qu’une faible et courte hydratation), halitose (mauvaise haleine).
- Fatigue (voire épuisement), avec pour conséquences : vertiges, étourdissements, syndrome des jambes sans repos, faiblesse musculaire, perte ou prise de poids, augmentation du taux d’acidité corporelle, engourdissement des membres (mouvements au ralenti, impression de lourdeur).
- Divers : bouffées de chaleur ou brusques refroidissements, sensation de chaleur sur certaines zones de la peau (notamment le visage), sensation de « vessie pleine » et miction fréquente, démangeaisons (notamment du cuir chevelu), transpiration excessive.

Effets psychiques (conséquences du stress sur l’état émotionnel)
- sentiment d’irréalité (impression de vivre dans un rêve) ;
- sentiment de dédoublement (impression de se trouver « à l’extérieur » de soi, de s’observer) ;
- sentiment d’impuissance par rapport à sa vie et son avenir (impression que notre destin ne nous appartient pas) ;
- besoin exacerbé de contrôle sur les autres et son environnement ;
- irritabilité, humeur changeante ;
- hypocondrie : scrutation fréquente du corps et analyse régulière de l’état général, à la recherche d’anomalies physiques ou de symptômes d’une maladie ;
- isolement social (accompagné paradoxalement d’une peur de la solitude) ;
- peur panique du ridicule ;
- besoin permanent d’être rassuré dans tous les domaines ;
- augmentation du nombre de phobies spécifiques (conduire, utiliser un couteau, se pencher au balcon…) ;
- odeurs et goûts « fantômes » (impression de sentir une odeur pourtant inexistante ou de manger un aliment périmé) ;
- manque d’assurance lors de la marche (remise en question de sa capacité à « bien » marcher) ;
- hypersensibilité aux stimuli (focalisation sur des détails tels qu’un vêtement un peu serré, une odeur désagréable, une légère gêne corporelle ou une minuscule coupure) ;
- consommation régulière de médicaments (notamment benzodiazépines) ;
- abus d’alcool et/ou prise de substances illicites ;
- sexualité perturbée (abstinence totale ou frénésie) ;
- crainte constante de la maladie et de la mort ;
- pharmacophobie (peur des effets des médicaments, même en cas de consommation) ;
- paranoïa (impression d’être scruté et jugé négativement en permanence) ;
- absences (déconnexions cérébrales momentanées) ;
- peur de sombrer dans la folie, voire de mourir (à cause de l’intensité de l’anxiété et de la profonde souffrance qu’elle engendre) ;
- dépression nerveuse.
__________________________________________________________________________
Les conséquences de l’insomnie chronique sur la santé

Le sommeil est la chaîne d’or qui relie la santé à notre corps.
Thomas Dekker (acteur et musicien américain)
Les conséquences du déficit de sommeil provoqué par l’insomnie se divisent en deux catégories : les conséquences de l’insomnie à court terme et celles de l’insomnie chronique (à long terme).
Les conséquences de l’insomnie à court terme
- Troubles de l’humeur (irritabilité, hypersensibilité…) ;
- Troubles de la concentration, de la mémoire et de l’apprentissage ;
- Augmentation de la tension artérielle (hypertension) ;
- Système immunitaire moins performant => plus grande vulnérabilité aux virus ;
- Somnolence diurne excessive => risque accru d’accidents de la route, du travail, de chutes…) ;
- Plus d’appétit et moins de sentiment de satiété ;
- Tendance à la consommation d’aliments riches en calories.
Les conséquences de l’insomnie chronique (à long terme)
- Augmentation du risque de maladies cardiovasculaires ;
- Risque d’AVC multiplié par 4 ;
- Risque accru de surpoids dû à la surconsommation à long terme d’aliments riches en calories ;
- Augmentation du risque d’apnée du sommeil et de diabète de type 2 liés au surpoids ;
- Risque accru de problèmes circulatoires ;
- Chez les hommes, diminution de 30 % du nombre de spermatozoïdes.

__________________________________________________________________________
Comment se libérer de l’insomnie chronique ?

Dans la partie « Comment retrouver un sommeil réparateur« , vous découvrirez les méthodes naturelles les plus efficaces pour vaincre l’insomnie chronique, mais aussi diminuer le temps d’endormissement et améliorer la qualité du sommeil.
![]() Les informations présentes sur ce site sont données à titre informatif.
Les informations présentes sur ce site sont données à titre informatif.
Elles ne remplacent en aucun cas l’avis d’un médecin ou d’un professionnel de santé.
En cas de doute, consultez toujours un professionnel qualifié.